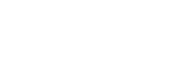Description de la soumission d'un avis

Institut de Neurobiologie de la Méditerranée

- Empreinte développpementale sur l'organisation fonctionnelle des réseaux corticaux
- Codage neuronal de l’espace et mémoire
- Activités précoces dans le cerveau en développement
- Adolescence et vulnérabilité développementale aux maladies neuropsychiatriques
- Bases neuronales des apprentissages sensorimoteur
- NICE2 : Épilepsies et encéphalopathies néonatales, du nourrisson et de l'enfance
- Codage neuronal et plasticité dans l'épilepsie
- Bases moléculaires et physiopathologie des malformations du cortex cérébral
- Empreintes périnatales et troubles neurodéveloppementaux
L’Institut de Neurobiologie Méditerranéenne (INMED) est un centre de neurosciences de pointe affilié à l’INSERM et à l’Université d’Aix-Marseille. INMED étudie le développement et la plasticité des synapses et circuits neuronaux dans le domaine de la santé et de la maladie. Récemment, le centre est devenu un chef de file pionnier dans le domaine de la neuroscience des systèmes de développement.
Au fil des années, la stratégie scientifique de l’INMED a consisté à rassembler des groupes partageant un but scientifique commun, mais avec des approches expérimentales complémentaires qui permettent de décrire et de manipuler la structure et la fonction des synapses et des circuits neuronaux avec une précision sans précédent dans des préparations intactes. INMED a été reconnu internationalement pour ses contributions dans les domaines de la neurophysiologie du développement et de l’épilepsie en réunissant des électrophysiologistes et des neuroanatomistes. Ces approches ont été renforcées au cours des dernières années par le recrutement de nouveaux scientifiques à la pointe, qui ont examiné les circuits neuronaux de deux perspectives différentes, les gènes et le comportement, ce qui a permis d’élargir l’expertise scientifique d’INMED à d’autres troubles du développement et à des maladies psychiatriques, ainsi que la compréhension du codage de l’information dans les circuits du cerveau des rongeurs, couvrant ainsi tout le spectre de la description du cerveau, de la molécule au comportement.
La neuroscience du développement et la neurophysiologie des circuits sont traditionnellement étudiées séparément pour des raisons techniques et historiques. INMED est maintenant devenu un endroit unique au monde où l’écart temporel entre les programmes de développement précoce et le codage de l’information dans les circuits cérébraux adultes des animaux peut être comblé.
Actuellement, INMED comprend 9 laboratoires indépendants, dont trois projets ERC et deux unités INSERM affiliées à l’international (LIA). Au total, INMED rassemble 150 membres. INMED héberge des installations et des services partagés organisés en plates-formes administratives ou technologiques : une plate-forme d’imagerie « Inmagic » qui comprend des microscopes à deux photons et à feuille de lumière, une plate-forme de biologie moléculaire et cellulaire « PBMC », deux installations pour animaux et un service qui permet le développement de nouveaux modèles de pathologies cérébrales basés sur l’électroporation in utero, un service d’histologie ainsi que l’une des plus grandes collections d’installations d’électrophysiologie (in vivo et in vitro).
Le laboratoire INMED en images



LES ÉQUIPES DE RECHERCHE
Les recherches des 9 équipes de l’Inmed sont développées par des chercheurs et enseignants chercheurs d’origine internationale, groupés en 9 équipes de recherche.
Empreinte développpementale sur l'organisation fonctionnelle des réseaux corticaux
DescriptionLa majorité des activités de réseaux corticaux adultes est dominée par une minorité active de neurones. Si peu de neurones sont actifs, il a cependant été montré que l’activité d’un neurone unique, comme les neurones hubs (Bonifazi et al. 2009) pouvait avoir un impact considérable, mesurable à l’échelle du réseau voir du comportement. Il apparait donc essentiel de comprendre les règles régissant la sélection de cette minorité active et dominante, et en particulier de comprendre si celle-ci s’opère au cours du développement.
L’hypothèse qui anime le travail de notre équipe est celle d’un lien entre l’origine temporelle embryonnaire d’un neurone et sa connectivité fonctionnelle dans le réseau adulte. Plus précisément, nous proposons que les neurones pionniers, générés aux stades les plus précoces de l’embryogenèse, sont programmés pour jouer un rôle central dans la coordination de l’activité neuronale, en conditions normales et pathologiques. Cette hypothèse se nourrit de nos travaux récents, ayant permis de décrire l’émergence d’activités coordonnées et de microcircuits GABAergiques fonctionnels au cours du développement postnatal. Pour tester cette hypothèse, et de façon plus générale pour décrire le lien structure-fonction dans les réseaux corticaux, nous avons développé une approche multidisciplinaire, combinant imagerie calcique et électrophysiologie in vitro et in vivo, description neuroanatomique, en particulier sur cerveau transparent, analyse mathématique et outils génétiques.
Rosa Cossart Total : 2 HDRs
- Imagerie calcique à deux photons (in vitro et in vivo)
- Électrophysiologie (in vitro et in vivo)
- Optogénétique
- Chirurgie animale, stéréotaxie
- Électroencéphalographie (EEG)
- Neurosciences computationnelles
- Génétique de la souris
- Neuroanatomie
- Microscopie par feuille de lumière
- Neuroscience des systèmes de développement
- Fonction de circuit hippocampique
Développement, Hippocampe, GABA, cortex, circuits, électrophysiologie, mémoire, codage neuronal, épilepsie.
Codage neuronal de l’espace et mémoire
DescriptionL’hippocampe est important pour notre capacité à nous localiser et à naviguer dans des environnements familiers (navigation spatiale). Notre équipe s’intéresse à la compréhension de la navigation spatiale et de son lien avec la formation de la mémoire épisodique.
Nous abordons cette question aux niveaux comportemental, réseau et cellulaire. Au niveau comportemental, nous entraînons les animaux à naviguer dans des environnements réels ou virtuels. Par rapport aux environnements réels, les environnements de réalité virtuelle permettent un meilleur contrôle des repères sensoriels externes dont dispose l’animal pour se situer dans l’environnement. Au niveau du réseau, nous utilisons des électrodes extracellulaires (par exemple des sondes en silicium) pour enregistrer l’activité de dopage de centaines de cellules dans la formation de l’hippocampe (hippocampe, cortex entorhinal) pendant que les animaux naviguent.
Parce que les enregistrements extracellulaires ne peuvent enregistrer que la production de dopage des neurones mais pas les mécanismes intracellulaires menant à ce dopage (entrées synaptiques et propriétés intrinsèques), nous avons aussi récemment contribué au développement d’une nouvelle technique permettant d’effectuer des enregistrements intracellulaires par patch-clamp des neurones hippocampiques chez les animaux navigateurs (Epsztein et al., 2011). Les enregistrements intracellulaires nous permettent d’étudier en détail les mécanismes cellulaires du codage spatial.
- Immunomarquages, histologie ou cytométrie en flux
- Electrophysiologie (sur tranches ou sur cellules)
- Electrophysiologie (in vivo)
- Chirurgie animale, stéréotaxie
- Comportement animal
- Optogénétique
- Réalité virtuelle
- Rôle des signaux sensoriels locaux dans l’établissement de la résolution du codage spatial de l’hippocampe (VR supplémentaire).
- Rôle des repères d’auto-mouvement et des repères visuels externes dans l’activation des cellules de la grille (VR supplémentaire).
- Rôle de l’excitabilité neuronale intrinsèque dans l’activation des cellules en place (patch anesth/VR).
- Effet de la locomotion sur la dynamique du potentiel membranaire des cellules principales de l’hippocampe (patch VR).
Réseau, hippocampe, comportement, environnement de réalité virtuelle, navigation spatiale, mémoire, mémoire, mémoire épisodique.
- Cognition et comportement des animaux
- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux
Activités précoces dans le cerveau en développement
DescriptionNotre équipe s’intéresse à l’activité du réseau neuronal, exprimé dans le cerveau dès les premiers stades de développement. En particulier, nous nous intéressons à la génération des modèles d’activité dans le cortex sensoriel (somatosensoriel et visuel) dans le but de comprendre les mécanismes neuronaux du réseau de la première configuration, les soi-disant « réactions en chaîne », et les rôles du cortex sensoriel dans la construction activité-dépendante des cartes corticales.
Par conséquent, nous extrapolons notre hypothèse faite dans les modèles animaux, aux nouveau-nés humains prématurés, dans le but de comprendre le fonctionnement du cerveau au cours des étapes du fœtus. Nous étudions également les changements développementaux dans la neurotransmission GABAergique et ses rôles dans la génération d’activités physiologiques et pathologiques dans le cerveau en développement (hypoxie, épilepsie et douleur).
Roustem Khazipov Total : 2 HDRs
- Biologie moléculaire (PCR...)
- Biochimie (Western blot...)
- Culture cellulaire
- Immunomarquages, histologie, cytométrie en flux
- Microscopie (à fluorescence, confocale, électronique...)
- Imagerie calcique
- Electrophysiologie (sur tranches ou cellules)
- Electrophysiologie (in vivo, chez l'animal)
- Chirurgie animale, stéréotaxie
- Pharmacologie
- Comportement animal
- Analyse du mouvement, posture, électromyogramme (EMG)
- Optogénétique
- Electroencéphalogramme (EEG)
- Bioinformatique
- Les modèles physiologiques de l'activité dans le cerveau en développement
- Les changements développementaux dans la signalisation GABA
- L'activité épileptique dans le cerveau en développement
- La neuroprotection du nouveau-né pendant l'accouchement
- Neurogenèse secondaire en lien avec la dépression post-traumatique
Développement néonatal, électroencéphalogramme, cortex visuel, GABA, épilepsie, hypoxie, dépression, neurogenèse secondaire, oxytocine, syndrome d’alcoolisation fétale, transporteurs au chlore.
- Cognition et comportement des animaux
- Développement de méthodes et technologies innovantes
- Développement du système nerveux
- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux
- Neurosciences computationnelles
- Pathologies du système nerveux
- Systèmes moteurs
- Systèmes sensoriels
Adolescence et vulnérabilité développementale aux maladies neuropsychiatriques
DescriptionNotre objectif général est de comprendre comment les microcircuits méso-corticolimbiques (MCL) sont formés au cours des premières périodes critiques de la vie, en particulier l’adolescence, pour donner lieu à des comportements émotionnels harmonieux et des fonctions cognitives adaptées à l’âge adulte. Plus précisément, nous voulons comprendre comment les insultes environnementales et génétiques modélisant les maladies neuropsychiatriques transforment l’architecture et la fonctionnalité des réseaux synaptiques et réduisent la plage de fonctionnement comportementale.
Nos travaux précédents ont alimenté le concept selon lequel les dommages structurels et fonctionnels durant les premières années de la vie, y compris l’adolescence, sont causaux dans les déficits comportementaux liés à la maladie. Notre hypothèse de base est que l’adolescence délimite une période de vulnérabilité maximale et est donc un déterminant critique de la façon dont l’environnement et les gènes façonnent les fonctions des réseaux neuronaux à l’âge adulte (Bara et al. 2018; Manduca et al. 2017; Labouesse et. al. 2017; Bouamrane et al. 2017; Iafrati et al. 2016; Iafrati et al. 2014)).
Notre projet de recherche permettra de réduite les phénotypes complexes en de nouveaux endophénotypes développementaux et de concevoir des stratégies thérapeutiques innovantes.
Olivier Manzoni, Pascale Chavis Total : 3 HDRs
- Microscopie
- Imagerie calcique
- Électrophysiologie
- Comportement animal
- Optogénétique
- Réseaux synaptiques de neurophysiologie
- Maladies neuropsychiatriques
Synapse, plasticité synaptique, accumbens, cortex préfrontal, endocannabinoïde, mGluR, pharmacothérapie, toxicomanie, autisme, X fragile, nutrition, adolescence, oméga 3.
- Cognition et comportement des animaux
- Développement du système nerveux
- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux
- Pathologies du système nerveux
Bases neuronales des apprentissages sensorimoteur
DescriptionLa survie des humains et des animaux dépend de leur capacité à apprendre de nouveaux comportements , à les adapter aux changements dans leur environnement ou se produisant dans leur propre corps et, dans certains cas, à devenir extrêmement compétents ou efficaces dans ce qu’ils font. Toutes ces fonctions dépendent de l’interaction complexe entre les processus sensoriels, moteurs et « cognitifs ». La fonction du système cortico-striatal est liée à l’apprentissage, mais sa contribution exacte aux multiples processus qui se produisent au cours des différentes formes d’apprentissage et d’adaptation est loin d’être comprise.
Il est important de comprendre la ou les fonctions du système cortico-striatal, car son dysfonctionnement est à l’origine de plusieurs maladies cérébrales telles que la maladie de Parkinson, le retard mental ou les troubles de l’hyperactivité qui, fait intéressant, sont caractérisés par un mélange de déficits sensoriels, moteurs et cognitifs.
Ainsi, notre équipe tente de délimiter la ou les contributions du système cortico-striatal au cours de l’apprentissage et de l’adaptation. Nous abordons cette question difficile en combinant un large éventail de techniques des neurosciences intégratives, dans le comportement des rongeurs (rats et souris), dans des préparations in vitro et avec des approches informatiques/théoriques.
David Robbe, Ingrid Bureau, Elodie Fino Total: 2 HDR
- Électrophysiologie (in vivo, in vitro)
- Histologie/Anatomie
- Chirurgie animale, stéréotaxie
- Comportement animal
- Analyse des mouvements ou de la posture (EMG)
- Optogénétique
- Électroencéphalographie (EEG)
- Analyse des données/Modélisation
- Programmation
Bases neuronales de l'apprentissage sensorimoteur et du contrôle moteur.
Apprentissage, ganglions basaux, cortex de baril, cortex moteur, codage neuronal, circuits, comportement, électrophysiologie, optogénétique, multi-électrode.
- Cognition et comportement des animaux
- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux
- Pathologies du système nerveux
- Systèmes moteurs
- Systèmes sensoriels
NICE2 : Épilepsies et encéphalopathies néonatales, du nourrisson et de l'enfance
DescriptionLes facteurs génétiques et non génétiques (virus, médicaments…) peuvent causer ou influencer un large éventail de troubles neurodéveloppementaux, y compris les épilepsies et encéphalopathies graves, qui peuvent être associés à des manifestations comorbides (par ex. troubles cognitifs ou comportementaux).
Malgré l’identification récente de divers gènes participant à ces troubles, les mécanismes pathogènes sous-jacents et la raison d’être du traitement restent encore mal compris. Dans ces conditions, il est obligatoire d’identifier les événements précoces susceptibles d’être modifiés au cours du développement du cerveau et de déchiffrer les processus pathophysiologiques sous-jacents.
L’équipe NICE2 a pour objectif d’étudier et de cibler les événements pathophysiologiques précoces associés aux épilepsies et encéphalopathies d’origine génétique ou non génétique, en utilisant des approches multidisciplinaires in vitro et in vivo.
Nous nous intéressons particulièrement aux altérations pathologiques qui surviennent tôt dans le développement du cerveau et qui peuvent avoir des conséquences profondes et à long terme sur le développement et le fonctionnement du cerveau.
Nos principaux objectifs sont :
- mieux comprendre les épilepsies pédiatriques et les encéphalopathies épileptiques d’origine génétique, et concevoir de nouvelles stratégies de sauvetage dans ces contextes ;
- d’étudier les événements pathophysiologiques secondaires, tels que les altérations neuroimmunes (par ex. dysfonctionnement de la microglie), qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la gravité, la comorbidité, le résultat et les réponses aux traitements ;
- déchiffrer l’impact des facteurs non génétiques (p. ex. infections virales) sur le développement du cerveau et, en fin de compte, sur les troubles du développement neurologique.
Pierre Szepetowski Total : 3 HDRs.
- Biologie moléculaire
- Biochimie
- Culture cellulaire
- Immunocoloration, histologie, histologie, cytométrie de flux.
- Microscopie (confocale, 2-photon)
- Électrophysiologie (in vitro, in vivo)
- Chirurgie animale, stéréotaxie
- Électroporation in utero
- Comportement animal
Nous étudions quatre modèles de rongeurs de différents troubles neurodéveloppementaux où des déterminants spécifiques et non spécifiques sont probablement impliqués, bien qu'à des niveaux différents, dans l'émergence et dans l'évolution variable des phénotypes. Ces troubles sont :
- Encéphalopathies épileptiques précoces liées à KCNQ2.
- Troubles liés à GRIN2A
- Troubles liés au TSC1
- Troubles liés au cytomégalovirus (CMV)
Epilepsie / Encéphalopathies / Développement du cerveau / Récepteurs NMDA / GRIN2A / Kv7.2 / Complexe de sclérose tubéreuse /Congénital cytomégalovirus / Microglie / Modèles de rongeurs
- Cognition et comportement des animaux
- Développement du système nerveux
- Pathologies du système nerveux
Codage neuronal et plasticité dans l'épilepsie
DescriptionNotre équipe s’intéresse au codage de l’information dans l’hippocampe, une structure impliquée dans la mémoire. Nous concentrons nos travaux sur le gyrus denté, se trouvant entre le cortex entorhinal et la zone CA3. Cette région est anatomiquement bien positionnée et physiologiquement prédisposée à jouer le rôle d’une porte, bloquant ou filtrant l’activité excitatrice du cortex entorhinal. Nous étudions le calcul neuronal et la plasticité des cellules granulées dentées dans des conditions normales et pathologiques. Nos études sont menées à plusieurs niveaux, c’est-à-dire de la colonne vertébrale jusqu’au microcircuit. Nous analysons également le rôle des molécules d’adhésion cellulaire impliquées dans le positionnement des canaux ioniques qui sont impliquées dans les maladies auto-immunes.
Valérie Crépel Total : 2 HDRs
- Électrophysiologie
- Culture cellulaire
- Imagerie calcique
- Immuno-histochimie
- Comportement animal
- Le codage de l'information dans l'hippocampe
- Le calcul neuronal et la plasticité des cellules granulées dentées dans des conditions normales et pathologiques.
- Le rôle des molécules d'adhésion cellulaire
Hippocampe, rongeur, épilepsie du lobe, maladies auto-immunes, gyrus denté.
- Cognition et comportement des animaux
- Excitabilité, transmission synaptique, fonctions des réseaux
- Pathologies du système nerveux
Bases moléculaires et physiopathologie des malformations du cortex cérébral
DescriptionNotre équipe étudie les Malformations du Développement Cortical (MDCs), qui sont des causes majeures de retard mental et d’épilepsie pharmaco-résistante chez l’enfant.
Nous réalisons des études multi-displinaires, impliquant morphologistes, biologistes moléculaires et électrophysiologistes. De plus, nous avons établi des collaborations avec des cliniciens et généticiens (projet Européen EPICURE), nous permettant une évaluation transversale de nos travaux de recherche.
Nous concentrons nos efforts sur :
- L’identification de nouveaux gènes et acteurs moléculaires impliqués dans les processus de migration neuronale, et étant perturbés dans les MDCs;
- Une meilleure compréhension du lien entre génotype et phénotype, et du processus conduisant à un patron de migration anormal;
- La caractérisation des mécanismes physiopathologiques responsable de l’épileptogenèse dans les MDCs, de façon à identifier précisément la zone génératrice des crises, à décrire ses propriétés et les mécanismes de genèse des crises, pour, à terme, suggérer de nouvelles approches thérapeutiques.
- Méthodes Histologiques et Neuroanatomiques,
- Biologie Cellulaire et Moléculaire (Interférence ARN, électroporation in utero),
- Culture cellulaire et d’explants,
- Enregistrements Extracellulaires Multi-sites sur Matrices d’électrodes,
- Imagerie time-lapse
- Identification de nouveaux gènes candidats impliqués dans la migration neuronale et les MDCs
- Mécanisme de genèse des MDCs
- Analyse Morphofonctionelle des réseaux hétérotopiques
- Répercussions fonctionnelles des défauts de migration neuronale : analyse du rat DCX knockdown
Développement du Cerveau, Epilepsie, Cortex Cérébral, Malformations du Développement Cortical, Migration Neuronale, Modèles Animaux.
Empreintes périnatales et troubles neurodéveloppementaux
DescriptionNotre équipe vise à identifier la physiopathologie de maladies génétiques qui affectent le neurodéveloppement de l’enfant afin d’améliorer la compréhension et la genèse de ces pathologies. Notre recherche est notamment centrée sur le syndrome de Prader-Willi une maladie apparentée aux troubles du spectre autistique et pour laquelle la génétique et l’épigénétique impactent le développement cérébral de ces patients.
Nous favorisons le développement de nouvelles approches thérapeutiques précliniques innovantes. Des approches périnatales dont le but est de prévenir l’apparition de certains symptômes sont actuellement évaluées. Ces approches se basent sur des thérapies médicamenteuses in vivo dans des modèles animaux murins pertinents et validés pour étudier le syndrome de Prader-Willi.
- Expérimentation et Chirurgie du petit animal
- Imagerie (Microscopie confocale, Vidéomicroscopie, Feuillet de lumière)
- Génétique
- Biologie Moléculaire et cellulaire
- Pharmacologie
- Connectomique
- Electrophysiologie
- Physiologie
- Tests de comportement
- Altération Ocytocinergique
- Sérotonopathie
- Génétique & Epignénétique
Empreinte génomique, Prader-Willi, Necdin, Magel2, oxytocine, comportement alimentaire, sérotonine, détresse respiratoire.